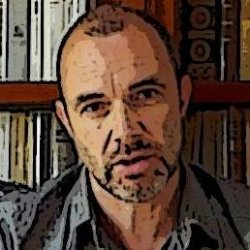
Éric Guéguen
Le monde actuel en 20 penseurs :Platon - Aristote - Lucrèce - Farabi - La Boétie - Montaigne - Spinoza - Rousseau - Hegel - Tocqueville - Nietzsche - Ortega y Gasset - Polanyi - Strauss - Arendt - Vœgelin - Villey - Dumont - MacIntyre - Lasch
--------------------------------
« Le citoyen typique, dès qu’il se mêle de politique, régresse à un niveau inférieur de rendement mental. Il discute et analyse les faits avec une naïveté qu’il qualifierait sans hésiter de puérile si une dialectique analogue lui était opposée dans la sphère de ses intérêts réels. Il redevient un primitif. Sa pensée devient associative et affective. »
(Joseph Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie, Quatrième partie, XXI, 3 (p.346)).
Contact : [email protected]
Le Miroir des Peuples, éditions Perspectives Libres, 2015
Tableau de bord
- Premier article le 05/12/2012
- Modérateur depuis le 28/02/2013
| Rédaction | Depuis | Articles publiés | Commentaires postés | Commentaires reçus |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 43 | 5127 | 2238 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
| Modération | Depuis | Articles modérés | Positivement | Négativement |
|---|---|---|---|---|
| L'inscription | 149 | 148 | 1 | |
| 1 mois | 0 | 0 | 0 | |
| 5 jours | 0 | 0 | 0 |
Ses articles classés par : ordre chronologique
Présidentielle 2017 : Plan de bataille des médias français

2138 visites 20 avr. 2017 | 5 réactions |
POLITEIA 28/30 - Des principes politiques véhiculés dans le sport

1551 visites 18 avr. 2017 | 10 réactions |
Alain Badiou sur la collusion entre "démocratie" et "capitalisme"

10767 visites 20 oct. 2014 | 84 réactions |
Les thèmes de l'auteur
Art Cinéma Citoyenneté Culture Démocratie Elections Europe Alain Finkielkraut Histoire Homophobie Humour Immigration International Islam Journalisme Justice Livres - Littérature Médias Aymeric Chauprade Eric Zemmour Grèce Guerre Polémique Présidentielle 2017 Spectacle Travail Philosophie Politique Religions Société Sport
Publicité
Publicité
Publicité







